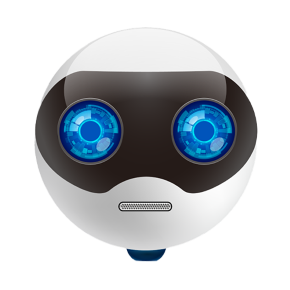IP | IT | Privacy Newsletter

Mars 2021

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
BREVETS
Clarification sur la requête en saisie-contrefaçon présentée en cours d’instance
MARQUES, DESSINS ET MODÈLES
Le défaut de distinctivité confirmé pour la marque « Giant » de Quick
Précision des critères d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale : le caractère « bio » ou non compte
DROIT D’AUTEUR – DROIT VOISIN
Signature d’un accord sur les droits voisins entre Google et la presse française : une avancée symbolique
IT – TECHNOLOGIES – DIGITAL
PRIVACY – DATA PROTECTION
CNIL : avis sur la loi « sécurité globale »
Violation de données de santé : la CNIL rappelle les obligations des organismes
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
BREVETS
Clarification sur la requête en saisie-contrefaçon présentée en cours d’instance
Dans un arrêt du 20 décembre 2020, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 1, n° 140/2020) a eu l’occasion de rappeler les règles applicables à la requête en saisie-contrefaçon présentée en cours d’instance.
Bien que l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle impose des conditions de délai pour saisir la juridiction au fond une fois les opérations de saisie-contrefaçon diligentées, le demandeur à l’action en contrefaçon peut solliciter l’autorisation de faire diligenter une saisie-contrefaçon une fois l’action au fond introduite. En effet, il peut y avoir intérêt pour établir que les faits de contrefaçon allégués perdurent ou pour déterminer l’étendue du préjudice subi.
La requête doit alors être présentée devant le juge du fond déjà saisi du contentieux, en vertu de l’article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile. En pratique, il s’agit du Président de la section de la 3eme chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris à laquelle l’affaire a été distribuée.
En l’espèce, l’appelant sollicitait la rétraction de l’ordonnance rendue sur requête par le Président de la 3ème section de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris au motif que le requérant n’avait pas justifié de l’existence d’une situation d’urgence. La question posée à la Cour était donc celle de savoir si les dispositions de l’article 812 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui conditionnent l’octroi d’une ordonnance sur requête à l’existence d’une situation d’urgence, sont applicables à l’ordonnance afin de saisie-contrefaçon rendue sur requête par le juge du fond en vertu de l’article 812 alinéa 3 dudit code.
La Cour répond à juste titre par la négative en rappelant que les dispositions de l’article 812 alinéa 2 du Code de procédure civile ont seulement vocation à s’appliquer aux ordonnances sur requête qui ne sont pas régies par des dispositions spécifiques. Or, l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit un régime spécifique d’ordonnance sur requête en matière de saisie-contrefaçon, ne prévoit aucune condition d’urgence.
MARQUES, DESSINS ET MODÈLES
Le défaut de distinctivité confirmé pour la marque « Giant » de Quick
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2021[1], a mis fin, au moins partiellement, à un feuilleton judiciaire opposant de longue date les sociétés Sodebo et Quick au sujet de la marque « Giant » et de sa distinctivité.
La société Quick restaurants est, en effet, titulaire de la marque internationale (n° 892 802) « Giant » couvrant la France, enregistrée le 14 juin 2006 et désignant divers produits et services de restauration en classes 29, 30 et 43. La société France Quick, gérant la chaîne de restaurants en France, bénéficiait d’une licence sur cette marque.
C’est dans ce contexte que, suite à la demande d’enregistrement le 3 février 2011de la marque française « Pizza Giant Sodebo » (n° 11 3 803 212), également en classes 29 et 30, par la société Sodebo, les sociétés Quick ont assigné celle-ci en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire, ainsi qu’en nullité de ladite marque « Pizza Giant Sodebo ».
La société Sodebo a, pour sa part, reconventionnellement, demandé l’annulation de la partie française de la marque internationale « Giant » pour défaut de distinctivité.
Si dans un précédent arrêt, du 14 avril 2015, la Cour d’appel de Paris[2] avait dans un premier temps fait preuve d’un certain assouplissement en considérant que « la marque GIANT [apparaissait] comme intrinsèquement arbitraire et distinctive pour permettre au consommateur d’identifier l’origine des produits et services qu’elle désigne », la Chambre commerciale de la Cour de Cassation avait déjà cassé cet arrêt en rappelant que « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique des produits ou services couverts par la marque et qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires »[3].
Ainsi, cette nouvelle décision de la Cour de Cassation de janvier 2021 fait suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 juillet 2018, rendu sur renvoi après cassation. Dans cet arrêt de 2018, la Cour d’appel a jugé le signe « GIANT » dépourvu de caractère distinctif et rejeté les demandes des sociétés Quick au titre des agissements parasitaires de la société Sodebo.
Sur l’appréciation du caractère du signe distinctif du signe « GIANT », la Cour de Cassation a confirmé la nullité de la marque « Giant » de la société Quick et, partant, rejeté ses demandes en contrefaçon. La Cour de cassation a, en effet, observé que l’usage des termes « long », « big », « double » ou ceux exprimant la quantité est banal dans le secteur de la restauration dite « fast food » et s’oppose à ce que ces signes usuels soient monopolisés par un concurrent. La Cour de Cassation ajoute également que l’adjectif anglais « Giant », était, à la date du dépôt de la marque nécessairement compris par le consommateur francophone d’articles de restauration, en particulier de « fast food », comme étant une caractéristique des produits désignés par la marque « Giant » (à savoir sa quantité « géante » ou « énorme »).
La Cour de cassation a également rejeté les arguments des sociétés Quick tenant à l’acquisition du caractère distinctif du signe « Giant » par un usage « continu, intense et de longue durée » soutenu par « l’importance des investissements publicitaires qui y sont consacrés ». Se fondant sur l’appréciation du public pertinent, la Cour de Cassation a jugé que les sociétés Quick n’apportaient pas la preuve que les consommateurs aient connu et identifié le signe « Giant » en tant que marque et non comme une caractéristique quantitative des produits vendus. Elle a également précisé que pour apprécier cet usage il est nécessaire de se placer à la date d’enregistrement de la marque « Pizza Giant Sodebo », en 2011, et qu’ainsi la Cour d’appel a pu, dans l’exercice de son pouvoir souverain, ne pas prendre en considération les sondages datant de 2014 présentés par les sociétés Quick au soutien de leur démonstration.
Néanmoins, cette décision ne met pas tout à fait fin au feuilleton judiciaire, puisqu’elle a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés Quick au titre des agissements parasitaires de la société Sodebo.
Sur un point, la Cour de Cassation a rappelé que le succès de l’action en responsabilité pour agissements parasitaires, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs (telles que les sociétés Quick après la confirmation de l’annulation de la marque « Giant » pour la France), n’est pas subordonné à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors, en considérant que les sociétés Quick n’avaient pas « démontré de risque de confusion entre le hamburger « Giant » commercialisé par l’enseigne Quick et la pizza « Giant Sodebo » vendue en moyennes et grandes surfaces », la Cour d’appel de Paris a privé sa décision de base légale.
A défaut de mettre un terme définitif au litige opposant les sociétés Quick et Sodebo autour de l’utilisation du signe « Giant », la décision de la Cour de cassation confirme la position des juridictions françaises tendant à faire preuve d’une fermeté stricte à l’égard de l’appréciation du caractère distinctif. Cette tendance doit être prise en compte avant tout dépôt de marque, puisque le risque d’annulation en cas de litige avec un concurrent est désormais loin d’être théorique.
Précision des critères d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale : le caractère « bio » ou non compte
La Cour d’appel de Dijon[4] a eu l’occasion dans un arrêt en date du 4 février 2021, relatif à un litige opposant la société SOFRAPAR et la société APPROCHIM au sujet de la vente d’engrais agricoles sous le signe « Ecobios », de préciser certains contours de l’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et ce à double titre.
D’une part, la Cour d’appel dijonnaise confirmant la décision de première instance sur la contrefaçon par imitation opérée par la société APPROCHIM a pris en compte, dans l’évaluation du préjudice moral subi par la société SOFRAPAR, le fait que le produit contrefaisant ne soit pas « bio ». En effet, la Cour d’appel a constaté que le produit de la société APPROCHIM « n’était pas « bio » et qu’il ne pouvait pas dès lors répondre aux exigences imparties pour une telle appellation », et qu’ainsi leur commercialisation aux côtés de ceux de la société SOFRAPAR, répondant eux à ces exigences du « bio », avait nécessairement causé à cette dernière un préjudice résultant d’une dépréciation de sa marque du fait de l’atteinte portée à son image.
D’autre part, la Cour d’appel a estimé que si la perte du chiffre d’affaires de la société SOFRAPAR servait de base à la fois à l’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et à celle de celui résultant de la concurrence déloyale, cela ne permet pas d’en déduire une double indemnisation d’un préjudice unique puisque les méthodes d’évaluation diffèrent ensuite. Compte tenu des régulières difficultés à conjuguer les actions en contrefaçon et concurrence déloyale, cet arrêt apporte un éclairage intéressant sur la proximité envisageable entre les préjudices en résultant.
DROIT D’AUTEUR – DROIT VOISIN
Signature d’un accord sur les droits voisins entre Google et la presse française : une avancée symbolique
Pour un bref rappel du contexte, les éditeurs et agences de presse déplorent depuis de nombreuses années la reproduction, sur le moteur de recherche Google, d’extraits de leurs publications comme s’il étaient libres de droits. Cette diffusion a pour effet de dissuader les lecteurs de se rendre sur leurs sites, privant en conséquence la presse d’une source importante de revenus.
S’appuyant sur la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019 (transposition de la directive (UE) n°2019/790 du 17 avril 2019) qui institue un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse, ces derniers réclamaient une rémunération associée à la diffusion large de leurs contenus sur le moteur de recherche. Face au refus de Google, les entreprises de presse ont fait appel à l’Autorité de la concurrence, qui a imposé à Google de négocier, rapidement et de « bonne foi », avec les demanderesses.
Ces négociations ont abouti, le 22 janvier 2021, à la signature d’un accord entre Google et l’Alliance de la presse d’information générale (APIG), présageant d’une rémunération de la presse française au titre du droit voisin. L’accord-cadre, d’une durée de trois ans, ne fixe à ce stade que les principes devant guider, ensuite, les négociations des accords individuels entre chaque membre de l’APIG et Google.
Si la reconnaissance du droit voisin revêt une importance symbolique, la portée de cet accord reste limitée dès lors qu’une partie de la presse écrite française (dont l’AFP) n’en est pas signataire et qu’il subsiste de nombreuses interrogations sur les modalités pratiques d’une rémunération de la presse.
IT – TECHNOLOGIES – DIGITAL
Accélération du renforcement des dispositifs de lutte contre les contenus illicites et la haine en ligne
Face à la multiplication constante de la diffusion de contenus illicites en ligne, tels que les incitations à la haine ou les propos injurieux postés sur les réseaux sociaux, la France se presse de renforcer les dispositifs permettant de mieux lutter contre ces comportements.
C’est dans ces conditions que le Gouvernement a déposé un amendement, quelques mois après la décision du Conseil Constitutionnel censurant largement la proposition de loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (dite « Loi Avia »)[5], ayant pour objectif d’introduire un mécanisme de contrôle des contenus illicites publiés sur les plateformes au sein de lu projet de loi confortant le respect des principes de la République. En effet, sous l’égide des dispositions légales et règlementaires actuelles, les obligations des plateformes – agissant le plus souvent en qualité d’hébergeurs – demeurent limitées.
Ce faisant, le Gouvernement anticipe, voire dépasse à plusieurs égards la récente proposition de règlement européen « Digital Services Act » (« DSA »), présentée par la Commission européenne le 15 décembre 2020, qui vise notamment à imposer au sein de l’Union européenne des obligations renforcées aux plateformes en matière de transparence et de lutte contre les contenus illicites sur internet.
L’amendement porté par le Gouvernement français vient compléter le dispositif prévu par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (« LCEN »)[6], en créant de nouvelles obligations substantielles à la charge des plateformes en matière de modération des contenus illicites, de transparence quant aux algorithmes utilisés pour retirer des contenus de manière automatisée ou encore de procédures de traitement des injonctions des autorités judiciaires ou publiques. Le contrôle de la mise en œuvre de ces obligations serait confié au Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA »), qui pourrait prononcer des mises en demeure, éventuellement suivies d’amendes administratives pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 6% du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent de la plateforme.
Une telle anticipation par la France (à l’instar de l’Allemagne ou de l’Autriche, par exemple) de la réforme envisagée par la proposition de règlement DSA (bien que les deux textes divergent à plusieurs égards), illustre la volonté des pouvoirs publics d’agir en urgence et de se doter de moyens plus efficaces de lutte contre les contenus illicites en ligne. La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions à l’échelle nationale pourrait également servir d’exemple et de socle de négociation du Règlement européen.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur du texte européen, les plateformes émanant la plupart du temps de géants internationaux pourraient cependant devoir jongler entre des exigences nationales divergentes entre les Etats membres de l’Union Européenne.
PRIVACY – DATA PROTECTION
CNIL : avis sur la loi « sécurité globale »
Le 26 janvier 2021, la CNIL a répondu à la première saisine effectuée par le président de la commission des lois du Sénat concernant la proposition de loi « sécurité globale » déposé le 20 octobre 2020. Cette proposition de loi prévoit des dispositifs techniques d’identification impliquant la collecte d’informations sur les personnes. Dans son avis, la Commission constate qu’en l’état, le cadre juridique envisagé n’est pas suffisamment protecteur des droits des personnes.
La CNIL s’est notamment prononcée sur les dispositions relatives à différents instruments tels que les caméras aéroportées, les caméras individuelles, la vidéoprotection et la mise en œuvre de caméras embarquées dans certains véhicules.
Plus précisément s’agissant des caméras aéroportées et celles embarquées, la CNIL recommande d’encadrer ces outils par de solides garanties au regard du RGPD et de redéfinir clairement les finalités pour lesquelles ces dispositifs seraient mis en place notamment pour assurer un équilibre entre le droit à l’information du public et le respect de la vie privée des personnes filmées.
La CNIL insiste sur l’attention particulière qu’elle accordera à la mise en œuvre effective de ces dispositifs. Afin de s’assurer du respect du cadre normatif ainsi établi, la CNIL rappelle qu’elle ne manquera pas de faire usage de ses pouvoirs de contrôle et, le cas échéant, de sanction.
Depuis plusieurs années, la CNIL pointe l’insuffisance des cadres juridiques pour l’utilisation de ces outils. Le 12 janvier 2021, la formation restreinte de la CNIL avait notamment sanctionné le ministère de l’intérieur pour avoir utilisé de manière illicite des drones équipés de caméra, en prononçant un rappel à l’ordre qu’elle avait décidé de rendre public ainsi qu’une injonction de faire cesser sans délai tout vol de drone équipé de caméras tant qu’un cadre normatif l’y autorisant ne serait pas instauré.
Violation de données de santé : la CNIL rappelle les obligations des organismes
A l’occasion d’une fuite de données de santé massive qui proviendraient de laboratoires d’analyses médicales, la CNIL a saisi l’opportunité de cette actualité pour rappeler les principes à respecter en cas de violation de données et le droit des personnes concernées.
Tout en alertant les établissements de santé des dangers tels que l’hameçonnage ou l’usurpation d’identité et de l’augmentation des cas de cybercriminalité, la CNIL réaffirme l’importance pour les responsables de traitement d’accroitre leur vigilance sur leur système de sécurité.
Elle rappelle ainsi que ceux-ci doivent mettre en œuvre des moyens proportionnés aux risques de violation de données :
- la notification des violations,
- l’analyse d’impact sur la protection des données
- ou les codes de conduite.
Ainsi, la CNIL attire l’attention des opérateurs sur sa volonté de renforcer ses contrôles, notamment dans le contexte de la crise sanitaire, afin de continuer à élever le niveau de sécurité des données de santé des personnes. La CNIL a d’ailleurs annoncé qu’elle orienterait ses actions de contrôles de 2021 vers les thèmes prioritaires suivants : la cybersécurité des sites internet, la sécurité des données de santé et les cookies.
L’équipe IP-IT de LPA-CGR avocats se tient à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires.
[1] Cour de Cassation, Chambre commerciale économique et financière, 27 janvier 2021 – n°18-20.702
[2] Cour d’appel de Paris, 14 avril 2015, n° 2014/14110
[3] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017 – 15-20.966
[4] Cour d’appel de Dijon, 2ème Chambre Civile, 4 février 2021 – n°18/01243
[5] Conseil Constitutionnel, 18 juin 2020, décision n°2020-801 DC
[6] Loi n°2004-575 du 21 juin 2004